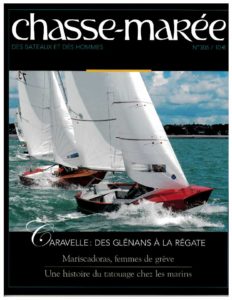Tarzan ne pique plus la morue
A 65. Ans, Robert Chauvin est toujours rock roll. Son T-shirt Harley Davidson et ses santiags à bouts carrés lui donnent l’air d’un vieux briscard ; ses bras couverts de tatouages racontent une vie mouvementée, mais il travaille aujourd’hui avec son fils et sa fille dans son studio situé sur le cours des Cinquante Otages, une des principales artères commerçantes de Nantes. Au début des années 1980, il était établi à deux pas de là, dans une petite rue discrète que fréquentaient aussi quelques péripatéticiennes. Le tatouage avait encore un parfum de soufre. « Une autre époque », constate-t-il. S’il est aujourd’hui reconnu comme le plus ancien tatoueur de la ville
-il dit « avoir piqué plus de cent mille personnes en près de quarante ans de métier »
– ses débuts furent pour le moins difficiles. Pupille de l’État, il grandit dans une ferme à Vezin-Le Coquet, en Ille-et-Vilaine, avant d’intégrer !’École des mousses de Saint-Malo en 1969, comme pensionnaire. Il y gagne son surnom : Tarzan, « parce qu’à quatorze ans, je ne que 40 kilos pour 1,33 mètres. »
Un an plus tard, il embarque comme novice pour une campagne de quatre mois sur le Louis Girard. Un chalutier classique de 75 mètres de long construit chez Dubigeon en 1957, appartenant à l’armement des Chalutiers Malouins. Tarzan fut donc pêcheur avant d’être tatoueur.
« Dans les années 1970, les marins de Saint-Malo avaient l’habitude de se faire tatouer à Halifax ou à Saint-Jean de Terre-Neuve, raconte-t-il, Et quand ils revenaient en France, ils montaient tous chez le seul professionnel français officiellement reconnu à l’époque : Bruno Cuzzicoli. dit « Monsieur Bruno », à Pigalle. C’est lui qui m’a fait ma tête de Christ sur la poitrine. On se piquait aussi entre nous, à bord. On faisait dans le carré, quand on était en mute, ou à cape, à main sans modèle, avec trois aiguilles ficelées. Pour fabriquer de l’encre, on faisait brûler une semelle de chaussure en caoutchouc au-dessus d’une assiette retournée et on diluait la suie avec de l’eau savonneuse. Les gars se chopaient de sacrées cloques avec ça, et quand ils montaient en passerelle pour demander de la pommade, ils prenaient un savon avec le patron. Mais il ne pouvait : pas être partout !
« J’ai commencé par dessiner des ancres, de5 pensées, des sirènes, des têtes d’indien, des voiliers ou des têtes de mort. Ensuite j’ai continué sur le Névé, un chalutier pêche arrière des Chalutiers malouins sur lequel j’ai été chef treuilliste jusqu’en 1977. J’étais plutôt bon à ce poste, ça payait bien mais j’avais envie de naviguer à Saint-Pierre pour lnterpêche, sur le Croix de Lorraine. J’ai embarqué le 1er janvier 1978 comme matelot, et je suis rapidement passé bosco. Le patron m’encourageait à étudier pour devenir capitaine au bornage mais je ne me suis pas présenté à l’examen : envie d’autre chose. En juillet, j’ai pris un mois de congé, j’ai acheté comptant une Chevrolet Nova et je suis parti à Québec voir le tatoueur Bruce Bodkin. Il m’a dessiné un dragon dans le dos et je lui ai dit que je voulais faire le même métier que lui. On est donc repartis avec ma bagnole jusqu’à Voorheesville, dans l’état de New York, voir Roger Spaudling, qui vendait des machines à tatouer. Bruce faisait l’interprète, j’ai payé 1000 dollars en Traveler Chèques et je suis rentré à Saint-Pierre avec une malle pleine. J’avais tout pour démarrer : des pigments noirs et de couleur, la formule secrète de la lotion pour les diluer, des dessins et un démographe. Je me suis installé 22 rue des Miquelonnais et j’ai déposé des cartes de visite dans les bars et sur les bateaux : c’était parti. Les gars débarquaient de partout en taxi et faisaient la queue devant chez moi. Je faisais ce que je voulais, ça payait bien et je n’avais plus froid aux mains ! En deux ans, j’ai tatoué toute l’île et la plupart des marins qui y relâchaient.
Tarzan décide alors de revenir dans la région rennaise, où il n’a plus d’attache. Il fréquente quelques mauvais garçons. « Ça ne s’est pas trop bien passé et j’ai préféré partir, poursuit-il. J’ai acheté une DS et je suis allé m’installer à Lorient. Personne ne voulait me louer un pas de porte et je me suis retrouvé à travailler dans une caravane, boulevard de Stalingrad. Je tatouais les commandos de marine, les gars du RIMA, pêcheurs, les dockers et les voyous. C’était une époque dure et je ne connaissais personne »
Au bout de dix-huit mois, un client lui conseille de s’établir à Nantes, car la ville est plus importante. « Je m’y suis installé en 1981, à peu près en même temps que Joe Marina, qui piquait quai de la Fosse. A l’époque, on ne comptait pas plus d’une dizaine de tatoueurs en France et les clients venaient de partout. » Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de salons sont implantés dans le centre-ville et le métier n’est plus ce qu’il était. « Avant, il fallait trouver les machines, les couleurs et connaître la formule pour les diluer. Il fallait aussi fabriquer ses aiguilles. Maintenant, tu trouves tout sur Internet et c’est facile de se lancer. La mode est arrivée avec le style tribal dans les années 1990 et cela a tout changé. Cela dit, je ne crache dans la soupe : il y a de vrais artistes parmi jeunes tatoueurs, certains ont même fait les Beaux-Arts et créent des œuvres originales. Moi aussi j’aime les beaux dessins, ceux qui demandent deux ou trois heures de travail, mais personnellement, je suis plutôt comme Johnny : « Ce qui m’énerve plus aujourd’hui, c’est le manque de respect. Ceux qui s’installent ne viennent plus nous voir pour se présenter et n’importe qui se tatoue. C’est de la consommation. Tu vois même des gamines arriver au salon et te dire « Je veux ça », en te montrant une étoile. Quand un gars qui avait trimé en mer attendait son tour plus d’une heure sans broncher avant de te lâcher 500 balles, ça avait quand même plus de classe ! »
Par Philippe Urvois, Le Chasse Marée